Groupement d’intérêt économique et environnemental

Les actus du projet
Nos derniers articles en lien avec le projet
Itinéraire technique des Vanilles des Iles de Guadeloupe
Vanilla pompona Schiede aurait pour origine les Antilles. Elle est notamment cultivée en Guadeloupe, où elle est nommée Vanillon ou encore Vanille banane.
Vanilles de Guadeloupe – Vanilla pompona
Vanilla pompona Schiede aurait pour origine les Antilles. Elle est notamment cultivée en Guadeloupe, où elle est nommée Vanillon ou encore Vanille banane.
Vanilles de Guadeloupe – Vanilla planifolia
GénéralitésVanilla planifolia est une liane de plusieurs dizaines de mètres, possédant une tige charnue et flexueuse. Des racines aériennes permettent sa fixation sur le support.Les feuilles sont planes, d’où son nom, ovales, épaisses, charnues et plus longues que les...
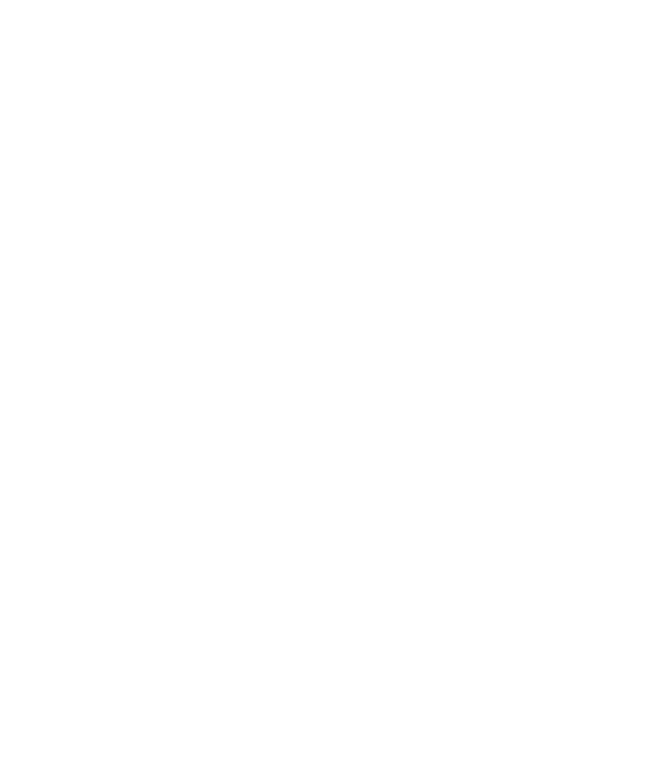

Le déroulement
du projet
La première partie du projet consistera en une phase de collecte de données compilant toutes les pratiques des agriculteurs ainsi que les problématiques et les verrous rencontrés.
Les résultats seront analysés lors des réunions collectives où il sera décidé de la forme de valorisation des données. Ces données auront pour but de trouver les synergies et problématiques communes.
Ensuite, un suivi des techniques sera mis en place pendant les 3 années du projet. Un rapport final de suivi d’indicateur (agro ET socio) sera réalisé à la fin du projet. Il pourra être agrémenté de mini-fiches techniques tout au long du projet, que nous vous partagerons !
En effet, des documents techniques seront produits sous différentes formes : fiches, vidéos, photos, etc. et valorisés à travers nos différents réseaux sociaux !
Les objectifs
Le projet GIEE de l’APAGwa permettra de contribuer à l’émergence d’une intelligence collective autour de la diffusion et de l’échange entre producteurs qui, parce qu’ils vivent sur des territoires particulièrement menacés par le réchauffement climatique et parce qu’ils sont tributaires des contraintes fortes liées à leur insularité, ont besoin d’augmenter et de pérenniser le volume des échanges et de s’enrichir mutuellement de leurs pratiques et expérience pour une transition agroécologiques. L’objectif principal du projet repose sur l’échange, le suivi et la diffusion de techniques agroforestières et agroécologiques. Ce partage entraîne également un dynamisme important entre les acteurs ultramarins et permet par la suite d’être mieux entendu par les autorités locales, régionales et nationales.
Objectifs économiques
Revalorisation des filières traditionnelles guadeloupéennes.
Apprentissage de la diversification de la production pour la diversification des revenus (« ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier »).
Augmentation du revenu moyen de l’agriculteur par la culture de filières à haute valeur ajoutée.
objectifs environnementaux
Valorisation des pratiques agroforestières et agroécologiques participant au maintien voire à l’augmentation de la biodiversité et des corridors écologiques sur le territoire.
Augmentation de la valeur des sols et lutte contre l’érosion.
objectifs sociaux
intégration des agriculteurs au projet en les mettant acteurs de leurs suivis réappropriation plus forte des pratiques.
Création de lien entre agriculteurs pour l’échange de pratiques : lutte contre l’isolement agricole (surtout pour les jeunes).
Création de valeur ajoutée sur la culture guadeloupéenne traditionnelle et les produits dantan.
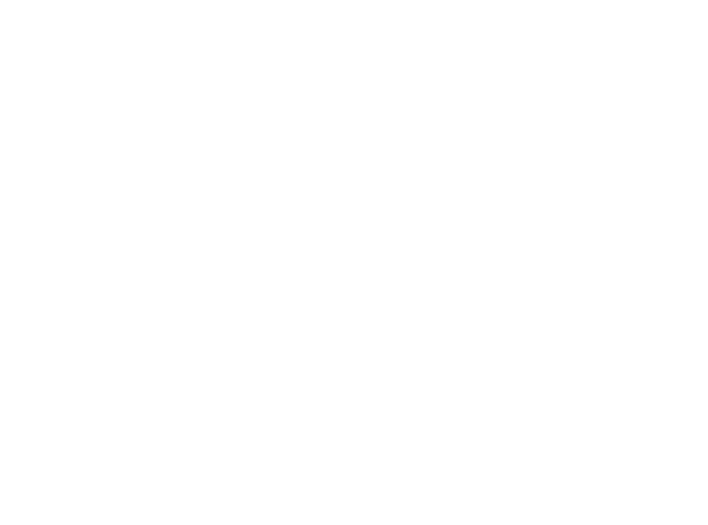
Problématiques actuelles des agriculteurs
- Pas de référentiel technique clair pour commencer / pérenniser l’activité.
- Aujourd’hui : trop de solutions standardisées, prises sans l’accord des agriculteurs et peu adaptées à la réalité du terrain : souhait d’une recherche au profit d’une diversité de systèmes à construire par les acteurs eux-mêmes dans chaque contexte socio-économique, écosystémique et sociologiques.
- Associer les savoirs des agriculteurs aux connaissances scientifiques et faire du vrai partage d’informations afin de produire des connaissances appropriables par le plus grand nombre.
- Réinscription des pratiques dans le temps long, celui des processus écologiques, celui des acteurs et celui des institutions.
Les agriculteurs
du GIEE
Les 11 exploitations engagées dans le collectif sont toutes des exploitations ayant exprimé le souhait de construire ou de pérenniser un système agricole diversifié agro-forestier et en agriculture biologique. L’ensemble des agriculteurs ont adoptés des pratiques agroécologiques au sein de leurs exploitations et qui se traduisent par :
- La diversification intelligente des cultures, où un travail de recherche d’association et de lumière a été réalisé.
- Un travail des cultures sans aucun produits chimique, toujours à la recherche de nouvelles façons de fertiliser les cultures de manière naturelle.
- Un travail principalement sous couvert forestier dense (concession ONF ou forêt privée), favorisant le travail manuel mais limitant les cultures exploitées / autorisées.
- Des systèmes d’exploitation extensifs avec une densité faible mais souvent tournés autour de cultures à forte valeur ajoutée inscrite dans un temps long, notamment avec comme produit phare fil directeur du GIEE : la vanille.
Le collectif présente plusieurs catégories de producteurs :
- Ceux qui sont installés depuis longtemps et qui possèdent un recul assez important sur leurs techniques pour conseiller le deuxième groupe ;
- Ceux qui sont installés depuis peu (<2 ans) et qui sont à la recherche de techniques de constitution de leurs agroforêts ou alors à la recherche de nouvelles techniques innovantes.
Le premier groupe permettra de poser les bases sur les itinéraires techniques et sur les verrous qu’ils ont su rencontrer et lever tout seuls. Ils apprendront au deuxième groupe certaines techniques à faire ou non sur l’exploitation.
Les deux groupes pourront ensuite tester et suivre tous ensemble de nouvelles techniques afin d’en faire le retour aux animatrices du GIEE et pouvoir co-construire un itinéraire technique adapté à tous niveaux.
Les études de durabilité : Comprendre pour agir mieux
L’une des premières étapes du projet GIEE a été la réalisation d’études approfondies sur la durabilité des exploitations membres. Ces diagnostics ont permis d’évaluer les pratiques agricoles sous plusieurs angles : agronomique, économique, environnemental et social.
Les résultats ont révélé des atouts comme la diversité des tuteurs et la richesse des systèmes agroforestiers, mais également des contraintes, notamment la vulnérabilité des lianes aux ravageurs et le manque d’accès aux ressources de qualité. Ces études ont servi de base pour orienter les actions du GIEE et structurer un itinéraire technique adapté aux réalités locales.
L’une des premières étapes du projet GIEE a été la réalisation d’études approfondies sur la durabilité des exploitations membres. Ces diagnostics ont permis d’évaluer les pratiques agricoles sous plusieurs angles : agronomique, économique, environnemental et social.
Les résultats ont révélé des atouts comme la diversité des tuteurs et la richesse des systèmes agroforestiers, mais également des contraintes, notamment la vulnérabilité des lianes aux ravageurs et le manque d’accès aux ressources de qualité. Ces études ont servi de base pour orienter les actions du GIEE et structurer un itinéraire technique adapté aux réalités locales.

Fiches techniques : Des outils pratiques à la disposition des agriculteurs
Dans le cadre du GIEE, des fiches techniques ont été conçues pour accompagner les producteurs dans leurs pratiques. Disponibles en téléchargement, ces fiches proposent des recommandations précises pour la culture de la vanille selon différents systèmes :
- Vanille sous ombrières : Focus sur la gestion de l’ombre et l’optimisation des rendements.
- Vanille en plein champ : Techniques pour adapter la culture aux contraintes climatiques et aux sols.
- Vanille en agroforesterie : Valorisation des interactions entre les arbres et les lianes.
Ces ressources sont un outil précieux pour les agriculteurs souhaitant améliorer leurs pratiques tout en adoptant une approche durable.
Les GIEE
Qu’est ce qu’un GIEE ?
Un GIEE (Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental) est un collectif d’agriculteurs (seuls ou avec d’autres partenaires) qui s’engage sur un territoire, dans un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Un GIEE favorise la mise en place de dynamiques au niveau local et constitue l’un des outils structurants du projet agro-écologique pour la France.
Qui peut prétendre au GIEE ?
Tout collectif, doté d’une personnalité morale, dans laquelle des agriculteurs détiennent ensemble la majorité des voix au sein des instances de décision peut prétendre à la reconnaissance de son projet.
Le GIEE bénéficie d’un cadre législatif volontairement souple. Une structure préexistante ou créée pour l’occasion peut être labellisée GIEE si le projet pluriannuel qu’elle propose correspond aux critères et aux orientations fixées, en cohérence avec le plan régional d’agriculture durable (PRAD). Aucun cadre n’est imposé pour la forme et le statut juridique, les regroupements entre agriculteurs sont encouragés sous toutes leurs formes.
Pour faciliter les actions communes, la loi prévoit que les actions menées par les agriculteurs membres du GIEE relèvent de l’entraide agricole (et non d’une relation commerciale ou salariale).
Qui pilote et attribue la reconnaissance d’un GIEE ?
Le dispositif est national, avec une mise en œuvre régionale. Les GIEE sont reconnus par l’État, via le Préfet de Région.
La reconnaissance des GIEE se fait sur la base d’appels à projets, organisés par le Préfet de région. Le dossier de candidature doit être déposé à la DAAF de la région où se situe le siège social du porteur de projet. Le préfet de région recueille l’avis de la formation spécialisée de la COREAMR (Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural), dont un représentant régional de la FNCUMA est membre de droit, et qui est présidée par le DAAF et le président de Région.
Au niveau national, dix critères minimum ont été définis : 1) objectifs de performance économique, 2) objectifs de performance environnementale, 3) objectifs de performance sociale, 4) pertinence technique des actions, 5) plus-value de l’action collective (organisation et fonctionnement), 6) pertinence du partenariat, 7) caractère innovant du projet, 8) durée et pérennité du projet, 9) modalités d’accompagnement des agriculteurs, 10) exemplarité, transférabilité ou reproductibilité du projet.
Chacun des critères reçoit un avis positif, neutre ou négatif. Pour être reconnu, le projet doit avoir obligatoirement un avis positif sur chacun des cinq premiers critères et un avis globalement positif sur les cinq derniers.
Le préfet de région accorde, le cas échéant, la reconnaissance comme GIEE, par arrêté, pour la durée du projet. Cette reconnaissance peut, dans certains cas, être retirée. La personne morale porteuse du projet doit réaliser au moins tous les trois ans un bilan, ainsi qu’en fin de projet. Les résultats des GIEE seront partagés avec l’ensemble des acteurs du territoire et feront l’objet d’une capitalisation conduite par les organismes de développement agricole, la coordination étant assurée par les Chambres d’Agriculture et l’APCA.
Comment est financé un GIEE ?
Il n’y a pas véritablement de financement dédié, sauf dans certaines régions.
Les actions prévues dans un projet reconnu dans le cadre d’un GIEE peuvent bénéficier de majoration dans l’attribution des aides ou d’une attribution préférentielle des aides. Celles-ci peuvent provenir de plusieurs sources et notamment de financements européens (FEADER, FEDER), de l’État, des collectivités territoriales ou d’organismes publics (ADEME, Agences de l’Eau).
Selon la nature de l’action réalisée, les bénéficiaires de l’aide pourront être les exploitations agricoles elles-mêmes, le collectif ou les partenaires qui contribuent à la réalisation du projet. La plupart des dispositifs sont rattachés à la politique de développement rural, pilotée par la Région. Les possibilités de financement sont donc différentes d’une région à l’autre, tout en s’appuyant sur le cadre européen.
Qui sont les GIEE en France ?
Depuis 2015, 753 GIEE ont été reconnus. Ils rassemblent plus de 12 000 exploitations (https://collectifs-agroecologie.fr/). Cet engagement commun dans l’agroécologie se traduit par une grande diversité de situations :
- par la taille des collectifs : entre une petite dizaine et plus de 100 agriculteurs, avec une moyenne de vingt agriculteurs ;
- par leur localisation, dans toute la France et les territoires d’Outre Mer, et leur échelle géographique, de la commune à la région ;
- par leurs productions, toutes les filières agricoles étant représentées, y compris l’apiculture ou les plantes aromatiques et médicinales ;
- par la diversité des partenaires avec qui ils travaillent : acteurs du développement agricole, de l’enseignement, de la recherche, collectivités territoriales, entreprises de transformation et distribution, associations environnementales etc. ;
- par les thématiques abordées, témoignant d’une importante transversalité des approches.
Quelle est la réglementation applicable ?
Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
- Décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif aux GIEE ;
- Instruction technique DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 relative aux GIEE ;
- Instruction technique DGPAAT/SDBE/2015-110 du 05/02/2015 (rectificatif) relative aux GIEE ;
- Décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la COREAMR sur les demandes de reconnaissances de GIEE ;
Instruction technique DGPE/SDPE/2019-29 du 15/01/2019 relative à l’accompagnement des collectifs d’agriculteurs en transition agroécologique.
Les encadrantes
Le projet est suivi au quotidien par 2 conseillères qui permettent de faire le lien entre les exploitations mais aussi d’apporter un soutien technique et un autre œil aux agriculteurs.
Marion Cassu
Marion fait partie du mouvement APAGwa depuis 2019. Elle coordonne et pilote les différents projets de l’association.
Elle s’occupe de mettre en place le plan d’animation spécifique de l’APAGwa et celui du GIEE. Elle veille au bon déroulement des actions et à l’accompagnement des membres, au sein de leurs exploitations d’un point de vue technique mais aussi administratif.
Émilie Barraud
Emilie Barraud a rejoint la communauté APAGwa début 2020.
Docteure en Anthropologie, elle rejoint l’APAGwa pour étudier les exploitations et les agriculteurs sous le prisme sociologique. Elle accompagne les membres sur leurs suivis d’exploitations et sur leurs projets futurs respectifs.


